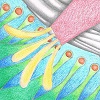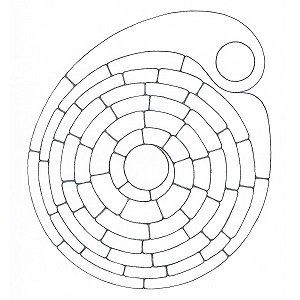![]()
Si l’être humain se réprime, se bat ou se condamne, il évolue dans le monde de ses pensées et de ses croyances.
S'il est appelé par la matière des besoins de son corps, il se soustrait à la dimension spirituelle et fondamentale de lui-même.
S'il existe dans l’illusion du mental, il pense que le monde lui est donné.
En réalité, rien n’est absolument à soi (dans le sens que l’individu perd finalement tout ce qu’il croit avoir), les multiples dépossessions, pertes et deuils sont les manifestations de cette évidence.
Ainsi, la question de posséder des biens (avoir) demande une certaine circonspection devant la certitude qu’il manquera toujours une chose (l’argent ne devrait servir qu’à l’utile et au nécessaire, non à l'assouvissement d'un désir effréné d’accumulation).
Afin d’éviter de voir le manque, il s’agit de regarder ce dont on dispose pour s’en servir davantage.
Comme le ressenti de bien-être décroît avec l’assouvissement du désir et sa temporalité, le sentiment de bonheur relève simplement de la capacité de contentement (joie, émerveillement, plaisir).
![]()
Un état d’inaction volontaire, considéré du point de vue du besoin satisfait, donc associé à l’absence de manque, représente une forme fugitive de bonheur (faculté d’être) puisqu’il existe dans l’instant présent dans lequel rien ne se produit de phénoménologique en dehors des dualités soi◄►soi et soi ◄►monde.
![]()
L’ennui se considère ainsi du point de vue de la conscience par sa dualité à un objet.
L'ennui manifeste le besoin d’exister par l’action (désir) dans la relation à l’autre.
L’ennui s’accompagne de perplexité anxieuse lorsqu’il existe par le manque dans l’attente de quelque-chose (désir) d’indéfini et l’impossibilité d’exister dans l’instant présent : « lorsque je ne perçois mon désir, je m’ennuie par son manque (absence) ».
L’ennui est ainsi l'absence de l'état immédiat de contentement dans l'inactivité, accompagné de l'idée d'un désir indéterminé (incertain) et de la prescience (doute) d’un manque : « est-ce que j’existe uniquement par mes désirs et la sensation du manque ? ».
Le sentiment de désespoir est, quant à lui plus catégorique puisqu'il manifeste l’envahissement du désir avec la certitude de son insatisfaction.
Il relève ainsi d'une combinaison émotionnelle vorace et aliénante de peur combinée à la tristesse.
![]()
L’art d’être heureux est donc une manière empirique (expérience) d’abolir l’attachement en modifiant son rapport au désir et au manque : « est-ce que j’existe de façon satisfaisante (entièrement) en l’absence de manque et de désir ? ».
L’état de vacuité (ni manque, ni désir) découvre alors l’unité de soi et les significations de sa nature profonde.