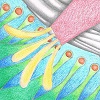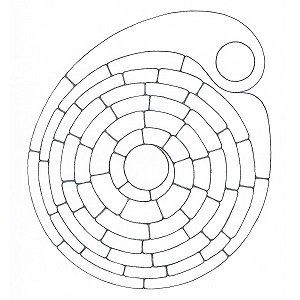![]()
Le désir naît d’un manque et de la perception de cet état d’insatisfaction.
Ainsi, tant que le manque n’est pas satisfait, il provoque la souffrance.
L’existence humaine naît sous le signe de l’absence et de la frustration (lié au stade d’indifférenciation et de dépendance absolue du nourrisson à sa mère), elle est soumise à une carence initiale douloureuse.
L’individu est donc heureux lorsqu’il satisfait le manque en évitant la souffrance (frustration), il atteint alors l’illusion du bonheur mais pas le bonheur en soi.
Dans ce cas, le bonheur relève d’un état de conscience rapporté à la phénoménologie (effets produits de la causalité), il est l’idée qu’il est le principe négatif de la souffrance (le bonheur réel et positif serait donc illusoire et irréel).
![]()
Si l’individu connaît la dimension du bonheur uniquement par l’absence de manque, il ignore le principe essentiel de dépassement des principes de la matière.
Étant donné que l’idée du bonheur n’établit pas de certitude (étant subjectif), il relève d’une utopie pour celui qui existe uniquement par le désir de la matière et l’ignorance de la possibilité de s’accorder sincèrement à soi et au monde.
L’individu qui dépasse les principes de sa matière accepte et intègre son début (généalogie), son existence (vécu d’expériences existentielles) et sa fin (mort) : « l’être existe sous une forme énergétique s’il se détache de sa matière, il n’existe alors plus en tant qu’individu mais en tant que soi (énergie-lumière-uni) ».
![]()
L'illusion de pouvoir accéder au bonheur en satisfaisant le manque met l’individu à distance des perceptions de sa réalité existentielle (être soi et ressentir les choses pour ce qu’elles sont).
En réalité, le bonheur est une pensée (représentation) qui se construit sur le sentiment de bien-être émotionnel déterminé par sa signification : « je suis heureux lorsque je me sens accordé au monde qui m’entoure ».
Le bonheur est donc une idée personnelle créée sur l’orientation symbolique de la perception subjective des ressentis : « pour moi, le bonheur c’est de pouvoir partager les sentiments ».
![]()
Le bonheur est donc un état global (psychique et physique) dans lequel la souffrance n'est pas nécessairement absente ou évitée : « ce n’est pas d’avoir la chose qui importe, c’est d’éviter les désagréments liés à l’absence de la chose ».
![]()
La réalité ouvre la voie de la conscience à sa propre perception pour la partager avec autrui.
« Si mes perceptions sont suffisamment transparentes, elles forment des liens avec toutes les représentations et symboles archivés dans ma mémoire.
Lorsque les pensées de croyance (convictions injustifiées) sont repérées par ma conscience, leur détachement (deuil, séparation, abandon, perte) volontaire me permet d’orienter différemment mes pensées.
C’est en acceptant les étapes émotionnelles (colère, tristesse, honte, peur, culpabilité) de détachement affectif avec sérénité que je retrouve la responsabilité de mes pensées et l’éclosion du monde intime de mes idées. Je reste toujours à l’écoute de mes émotions car elles me permettent des stratégies de comportements et d’actions concrètes afin de m’adapter raisonnablement mais également intuitivement à mon environnement immédiat ».
![]()
L’introspection est une réflexion lucide sur soi.
« Mon discernement s'oriente vers moi-même par ma volonté de comprendre mes idées et tous les éléments de mes pensées.
C'est ainsi que je puis remédier aux difficultés liées aux évaluations corrompues de mes représentations dans certaines situations.
Comme le monde est une représentation projetée de ma conscience et de mes perceptions dans la réalité, j’agis sur ma représentation du monde et de moi-même en nourrissant la pensée que ce que j’imagine se concrétise dans mon existence.
J’imagine alors que la lumière et la paix atteignent le centre de mon être ».