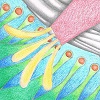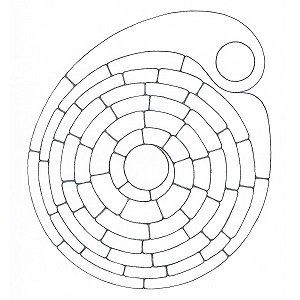![]()
Être conscient commence par le discernement des perceptions, des sensations et des ressentis qui consistent à identifier les situations pour être capable de réagir.
Un organisme simplement fonctionnel permet d’être conscient par sa présence et son ouverture au monde et à lui-même.
Être conscient, c’est donc percevoir le monde par l’expérience de la conscience perceptive immédiate : « je perçois le monde qui m’entoure » en ce sens, ne pas être conscient c’est être endormi, ivre ou atteint d’une pathologie de la perception.
Être conscient, c’est également être conscient de soi par la perception de soi : « je perçois ma présence dans le monde que je perçois », par la réflexion et le discernement de la conscience perceptive réfléchie sur soi.
En ce sens, ne pas être conscient de soi, c’est être le somnambule qui perçoit mais ne se perçoit pas lui-même percevant, ne ramenant pas à lui-même la perception de sa promenade.
La conscience est donc une attention concrète portée à soi au présent, elle se réalise et apparaît par la pratique des perceptions et des projections à chaque rapport au monde : « ma conscience accompagne chacune de mes perceptions et chacun de mes actes, elle considère la réalité dont je fais l’expérience à chaque instant ».
La conscience est également intention et prévision vers ce qui va advenir, dans le sens que « ce que je réalise dans mon présent engage un présent qui va devenir un avenir possible ».
![]()
La représentation du monde est une image mentale fabriquée, au même titre que la représentation de soi en tant qu’images créés par la conscience pour comprendre et définir la relation qu’elle entretient avec son environnement et avec elle-même.
La représentation que l’individu créé du monde détermine alors la nature de ses perceptions, comportements et projections : « mieux vaut être optimiste et se tromper parfois, qu’être pessimiste et se tromper toujours ».
Chacun existe selon sa conscience, les projections de chacun émanent ainsi d’intentions, de pensées et de sentiments singuliers manifestant le sens individuel (personnalité) donné à la vie sur le plan des nécessités (besoins) et des désirs.
![]()
Les projections annoncent les contenus représentatifs : « si je me montre jaloux, je signifie que je n’ai pas confiance ni en moi ni en l’autre et que je considère que le monde est malveillant par le mensonge, la trahison et l’illusion », dans ce cas il s’agit de regarder sa représentation du monde et de questionner la représentation du moi : « pourquoi suis-je démuni devant les événements, suis-je dépendant d’une relation qui me fait peur, suis-je soumis à un objet qui invite au soupçon ? ».
Les projections, la connaissance, la réalité et la congruence de la représentation du moi éclairent ainsi la conscience sur la personnalité : « si je suis mes projections et que je ne suis pas exactement ce que mes projections racontent, mes perceptions et mes émotions excitent un conflit de représentations, construit d’une image de moi-même distincte de qui je suis en réalité ».
C’est ainsi qu’une connaissance insuffisante de la personnalité réfute la réalité ou la légitimité des actions : « lorsque je pense qu’il était insensé de faire cela ou que j’ignore pour quelle raison j’ai dit ceci, je ne me reconnais pas dans mes actions et mes choix de vie, je parais alors étranger à moi-même ».
![]()
Comme les représentations mentales sont orientées par la subjectivité des perceptions, elles peuvent diverger de la réalité.
La connaissance, la critique et l'ajustement des représentations affirme la validité des actions : « lorsque j’évalue une situation, j'observe mes perceptions et je prends conscience de mon état d’être émotionnel pour projeter les sentiments idoines et agir de manière adaptée et cohérente ».
Il est donc primordial de questionner la représentation de soi : « suis-je réellement celui que je perçois et que je manifeste ? », notamment dans le cas d’une représentation créée sur des idées de soi inculquées ou détournées de l’expérience personnelle concrète et lorsque l’image de soi apparaît tantôt telle la réalité et parfois comme l’illusion d’un masque (personnalité) rigide.
« Si je crois savoir qui je suis et pense agir en pleine conscience mais que je ne reconnais pas mon image dans le regard d’autrui, je comprends que celui que je crois être n'est pas celui que je suis ».
La figure du masque est alors l’obsession, la geôle ou la forteresse de la conscience (soi), troublée par une représentation figée et impérieuse : « je suis celui qui erre dans le rêve de mon existence sans se nommer, tel un fantôme ».
Il est donc important de reconnaître toutes les expressions verbales, écrites, graphiques, sonores, gestuelles authentiques de la pensée et de soutenir les projections émotionnelles dans l’espace de la matière pour favoriser l'introspection, l’analyse et la compréhension d'une représentation du moi.