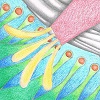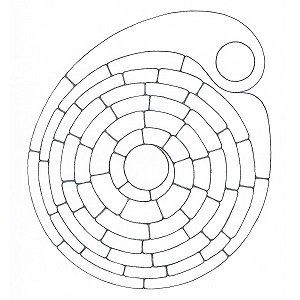![]()
L’histoire et les circonstances généalogiques constituent le monde primitif, social et relationnel de l’enfant qui forme et modifie ses attitudes et ses traits de personnalité en fonction de l’environnement dans lequel il évolue.
La nature humaine (personnalité) émerge ainsi de l’identification aux rôles parentaux et à ceux de contiguïté sympathique (fratrie, cousins, amis, éducateurs), eux-mêmes émergés de l’identification aux figures de tous les autres pour répondre aux besoins de conformité et de similitude créés par la communauté (milieux d’appartenance, de référence, d’attachement et d’affinité).
Sachant que l’individualisation plonge ses racines dans les images représentatives et structurantes du déterminisme (causalité) et de la perpétuation (loyauté à l’inconscient familial), la question de la personnalité renvoie aux rôles du milieu d’appartenance.
![]()
Lorsque le choix conscient d’un rôle s’oppose à la personnalité profonde, l’émotion (peur, colère, tristesse) exprime la contradiction.
Il est alors nécessaire de faire évoluer le rôle par la pensée en comprenant les processus inconscients qui ont engagé la conscience sur une voie incongrue.
Il est question des besoin d’appartenance, de reconnaissance, d’amour et d’estime dès que l’individu existe par son individualité et sa représentation (statut) dans le regard de l’autre.
Il s’agit des besoins de réalisation, de participation, d’évolution et d’apprentissage (rôle) quand il existe par son caractère authentique dans son propre regard.
![]()
Ainsi, la restauration de l’équilibre émotionnel et la (re)conquête de la liberté individuelle sont toujours basées sur le questionnement des premières identifications : « je me suis construit lorsque j’ai conçu mes premiers rôles ».
Questionner les ressemblances de caractère questionne le sens des identifications et leurs adaptations.
Saisir et interpréter les raisons (rôle) d’un rôle : « quelles sont les causes de mon identification à mon oncle plutôt qu’à mon père ? » c’est (re)créer, par soi-même son propre rôle au présent par la volonté du choix, du questionnement, de l’intuition, de l’imaginaire et du discernement par l’attention accordée aux perceptions de soi (émotions).
![]()
Dans la mesure où la réalité des fonctions du rôle (activité, obligations, règles) correspond au caractère (congruence du rôle et de la réalité émotionnelle de soi) et aux attentes de l’individu, le rôle permet des possibilités relationnelles et existentielles infinies (par volonté, désir, continuité) permettant une réalisation de soi : « je suis l’explorateur de ma propre existence ».