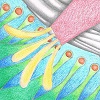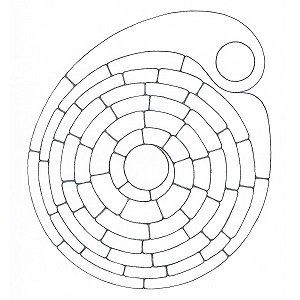![]()
Les premières expériences relationnelles de l’être humain avec le monde qui l’entoure se produisent par les ressentis de ses perceptions sensorielles.
Par son état d’incomplétude psychique, ses sensations s’inscrivent dans son espace inconscient, indifférencié du monde environnant.
C’est ainsi que les identifications de la relation triangulaire (enfant – mère – père et substituts) sont instinctuelles.
L’inconscient est donc l’espace d’ancrage du soi originaire de la conscience du nourrisson dans lequel s’inscrivent ses premières représentations sensorielles et émotionnelles, celles de ses besoins corporels fondamentaux (boire, manger, respirer, dormir, se mouvoir, éliminer, être propre, homéothermie) ainsi que les représentations primitives du monde indistinct dans lequel sa perception des objets extérieurs semble provenir de l’intérieur de lui-même.
Ainsi, l’identification aux rôles n’est pas le premier mécanisme qui créé l’enfant en tant qu’individu unique, elle agit au dernier stade d’individualisation de la relation triangulaire de l’œdipe.
![]()
L’état inconscient originel (soi) voit émerger la conscience (moi) à l’issue de la période d’indifférenciation lorsqu’elle acquiert (3 à 6 mois) la capacité de sa propre symbolisation.
À partir de ce moment, les ressentis sensoriels participent à la constitution de la personnalité émotionnelle par la conscience de la perception de soi : « qu’est-ce que je ressens » et symbolique : « pourquoi je ressens ».
Les identifications primitives (mère – père – soi) inscrites dans la conscience de l’enfant au travers de ses sensations, émotions et représentations de l’être humain individualisé (soi – autrui) lui permettent de discerner et d’intégrer progressivement les conduites sociales et comportementales de son entourage.
Les imitations qu’il réalise des rôles sociaux soutiennent la construction de son caractère, de son identité et de ses représentations sociales, développant sa conscience.
L'enfant sauvage devient ainsi un enfant social.
![]()
Les premiers jeux de rôles (6 mois à 3 ans) développent le caractère, étant un jeu libre ne comportant de règle.
L'enfant s’identifie d’abord au monde environnant en intériorisant successivement les diverses représentations (rôles parentaux).
Puis il joue les rôles en miroir en jouant pour lui-même le rôle d’autrui.
L’enfant imite le parent puis il s'imite en manifestant à son propre égard les comportements qu'il a agi vers autrui (rôle de la poupée), il comprend les articulations symboliques et les implications émotionnelles de chaque individualité, c’est ainsi que, parlant de lui-même : « regarde chéri, il a renversé son bol de lait - il doit demander à maman le chiffon pour nettoyer la tache sur son chausson – je vais te donner le chiffon mais tu n’auras plus de lait car tu n’as pas fait attention – je crois que maman est fâchée - c’est parce-que tu regardais les rossignols – je regrette, j’aurais du regarder mon bol ».
La nature des expériences affectives et la symbolisation concrète que l’enfant réalise naturellement au travers de ses jeux de rôles orientent alors la définition de son caractère (son rôle en regard à sa propre conscience).
L’apprentissage du domaine collectif s'effectue ainsi par l’introjection et la compréhension des divers modes relationnels (liens, attitudes, enjeux, intentions).
Les premiers rôles mis en scène, conçus et tenus au sein de la famille forment l’apprentissage des règles collectives et conditionnent l’évolution de sa socialisation.
![]()
L’organisation de la communauté, sa culture et son histoire transgénérationnelle s’expriment par les coutumes, pensées, perceptions et représentations au travers des rôles familiaux.
Le second stade du jeu de construction sociale est identitaire par l’introduction des règles, valeurs, croyances et conventions propres à l’espace familial (privilèges, obligations, interdits).
![]()
L'enfant s'implique dans ce jeu codifié, incorporant le cadre structurant du groupe en interprétant les rôles (fonctions) et les statuts de son entourage.
À partir de ce moment, le rôle se constitue sur la pratique du discernement et de la compréhension des liens, règles et enjeux relationnels.
L’enfant créé sa contribution à l’ordre et au modèle familial, il intègre le monde des systèmes et des processus d’organisation des tâches.
La définition de son rôle et l’attribution de son statut l’engagent sur la voie de la loyauté (interdépendance) au groupe culturel. Identifié au rôle, l’enfant peut alors prétendre au droit à l’autonomie identitaire et à l’indépendance de sa personnalité.
Les jeux de rôles trouvent leur apogée entre 3 et 6 ans avec une croissance dans la complexité des scénarios.
Les rôles interprétés dans le groupe d’appartenance forment les outils de construction et de développement du désir existentiel lié à la conscience de soi : « je suis désiré par mes parents comme un élément de leur existence, je désire (identification) alors jouer un (mon) rôle car je suis celui qui soutient leur désir (introjection) ».
![]()
L'identification est également un processus d'influence et d’apprentissage constituant un moyen d'intégration aux normes du groupe.
C’est ainsi que l’adulte incarne les identifications et les conditionnements de son enfance qui lui permettent de fonctionner dans sa société culturelle.
Certaines personnes éclosent en portant un rôle prédéterminé, s’agissant généralement de l’enfant articulation du couple, de l’enfant prolongement narcissique d’un parent, de l’enfant remplaçant de l’absent, de l’héritier relais ou renouveau d’une noble généalogie, de l’enfant objet de la permanence et de la continuité du nom, d’autres ne jouent aucun rôle et ne remplissent aucune fonction :
« j’ai plus ou moins accepté les règles et les significations m’ayant été inculquées au fil des années, que je les aie acceptées complètement ou que j’ai essayé de façonner une direction indépendante, mes comportements ont été sculptés par les attentes des autres, la perception de moi-même porte l’influence de leurs attitudes et jugements ».