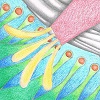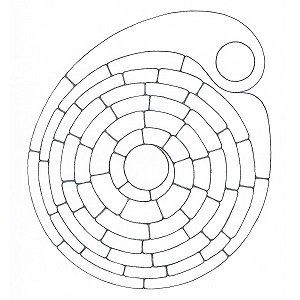![]()
Nous avons vu que le rôle établit le rapport fonctionnel de l’enfant avec la société familiale en tant qu’échantillon de société universelle : « mon rôle est de débarrasser la tablée et d’aller jouer dans le jardin ».
En plus de sa fonction identitaire produite du statut : « je suis l’enfant de mes parents », le rôle est un moyen d’interaction avec les objets environnants : « je leur fais des câlins ».
Les rôles s’élaborent ainsi comme des organes relationnels et se manifestent dans tous les milieux sociaux.
Les fonctions (actions) du rôle sont ainsi au centre de la relation de l’individu avec son environnement, c’est particulièrement par la mise en jeu de son rôle que le contact de soi avec autrui se produit (le rôle de l’un répond à celui de l’autre).
Les membres d’un groupe se différencient alors par la contribution de leurs rôles et d‘après les tâches qu’ils effectuent, l’individu existe alors dans le groupe social au travers de sa fonction (utilité aux buts communs) en étant identifié par son rôle répondant aux besoins du fonctionnement communautaire qui le légitiment.
![]()
Les multiples rôles d’une personne constituent les essais et les expériences identitaires de son évolution : « j’ai été chauffeur, photographe, poète, chef de rayon, coureur cycliste, garde du corps, à présent j’essaie d’être moi ».
Par conséquent, les rôles ne sont pas figés (variance des rôles), ils évoluent avec les expériences existentielles et les nécessités d’adaptation individuelle.
L'individu est donc capable d'assumer de nombreux rôles manifestant normalement son harmonie intérieure et illustrant son principe intérieur fondamental (congruence) : rôle culturel lié à la transmission d’une connaissance ou d’un savoir (guide, philosophe, enseignant), rôle sectorisé lié aux compétences, à la division du travail et au partage des tâches (profession, fonctions domestiques), rôle contextuel lié à une situation (témoin, sauveur, victime, malade, protecteur), rôle sociologique lié aux rapports humains (divorcé, médiateur, messager, arbitre), rôle de genre lié aux caractéristiques physiologiques (type de genre et d’âge, corpulence, couleur).
Par ailleurs, l’individu peut se reconnaître dans certains rôles caractéristiques des contes :
le protagoniste est le créateur d’une situation émotionnelle (mission) ou symbolique (énigme)
la cible mobilise la volonté (intentions) d’un groupe ou d’un individu par une procédure dont la finalité est la reconnaissance, la poursuite d’un rêve, la quête d’une récompense symbolique
le commissionnaire (père, mère, autorité, autre) détermine par son statut l'objet ou la nature de l’aventure existentielle et autorise les protagonistes à tenir leurs rôles
le messager porte la signification et dévoile les règles (conditions)
l'agresseur (le méchant) ayant perpétré un méfait cristallise tous les sentiments rejetants du groupe
l’usurpateur (le faux-soi) fait valoir des prétentions mensongères à un statut (subtilise la place d’un personnage absent)
le protecteur (l’allié spirituel) procure l’outil matériel ou symbolique d’équilibre (résolution du conflit)
le bâtisseur œuvre à la réalisation de l’aventure existentielle, il peut être l’outil absolu et complet en réalisant toutes les fonctions (statut et rôle), partiel en accomplissant plusieurs fonctions limitées (rôles diversifiés) ou spécifique en présentant une seule fonction (rôle unique)
![]()
Étant lié à des interactions sociales dynamiques, l’individu s’identifie au rôle pour s’exprimer, transmettre un savoir, évoluer, apprendre d'autrui ou d'une situation, partager et échanger dans les activités professionnelles, ludiques et créatives : « tenir un rôle soutient l’expression et l’affirmation de soi et permet de vivre pleinement les relations affectives (être aimé, écouté, compris, soutenu) par la reconnaissance des caractères et le partage des pratiques ».
Ainsi, le rôle est un outil de croissance, d’inspiration, d’harmonie, de satisfaction et d’adaptation aux changements (résilience).
L’individu social existe de la reconnaissance sociale qu’il reçoit d'autrui pour la conformité des charges (statut) qu’il porte et de l’activité qu’il produit, le rôle est donc un facteur d’intégration aux groupes et aux contextes sociaux.
Par son caractère signifiant, il rend compte de la nature et de l’influence de son mode relationnel dans un domaine d’application particulier : « je suis le Père-Noël (figure représentative du groupe social), mon rôle est de donner des cadeaux (réponse au besoin de reconnaissance) aux enfants obéissants à leurs parents (condition et objet du désir) ».
La déformation professionnelle est l’incongruité du rôle par son intrusion dans un espace inapproprié.
![]()
Par le défaut d’une identification de proximité aux images parentales, précoce, adaptée, reconnue, approuvée, authentique et particulièrement réaliste, l’individu est en sursis d’un état d’être congruent, suspendu à l’attente d’une reconnaissance impossible il est soumis à la frustration permanente.
Soi-même n’étant réellement identifié au rôle par la falsification de sa réalité symbolique et de ses représentations (distorsion de l’image de soi), il est à l’affût des autres dans un conflit entre l’activité du rôle et l’intérêt du statut.
Les rôles éclairent alors la personnalité et le désir de statut : « je souhaite absolument être reconnue comme une mère », les significations du rôle (ses raisons symboliques) exposent ainsi le rôle du rôle : « le rôle de parent aurait-il pour rôle de me guérir de ma faille narcissique ? » puisque le rôle comporte toujours des éléments de la conscience de soi (sentiments, croyances) : « je donnerai à mes enfants l’affection que je n’ai pas reçue (frustration) » et des caractéristiques prédominantes reliées à des images parentales particulières ayant formé les prémisses des représentations de soi (estime de soi) : « mes parents ne m’ont pas suffisamment aimée (cause), je serai donc pleine d’amour pour mes enfants (désir de réparation) ».