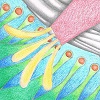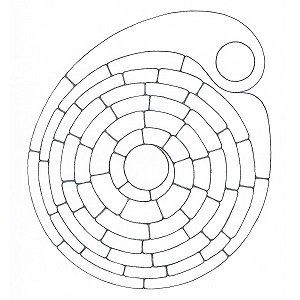![]()
Les parents accompagnent les enfants dans les phases successives d’évolution pour leur permettre d’atteindre sereinement l’autonomie psychique et matérielle.
Transmettre une connaissance existentielle (connaissance de soi) et porter une reconnaissance identitaire à ses petits découle d’une volonté bienveillante.
Lorsque l’éducation ne reconnaît pas l’ipséité, elle repose sur un travail d’ensemencement de croyances et de représentations mentales.
Certains sont alors déterminés par leur éducation, parsemée de règles et d’injonctions différentes à chaque stade de leur évolution.
La désapprobation : « je suis mécontent de toi », les restrictions : « ne fais pas ci », l’orientation des comportements : « fais ça », les récompenses et les punitions de conditionnement : « si tu es sage nous irons au parc » engagent l’individu sur la voie de l’interdit (frustration), du dogme (vérité) et de leurs effets (croyance).
L’enfant qui prend de l’assurance en grandissant se confronte à des contraintes (obligations) sociales et autoritaires toujours plus nombreuses.
Les excès d’exigences et de règlements dans tous les domaines se déploient ainsi dans le contexte oppressif de la peur de ne pas être suffisamment aimé de ses parents.
Ce décor ne soutient pas l’individualité et n’incite pas l’enfant à exister réellement.
Comme le vécu émotionnel et symbolique retentit sur les choix du libre-arbitre, l’individu devenu adulte sans discernement, ignorant ses raisons profondes (réelles) fait et croit en des choses par déterminisme (destinée) ou par conditionnement (automatisme) car ses parents étaient convaincus de la vérité de leurs croyances (la vérité relève davantage de la croyance et des actes plutôt que de la réalité qui se créé des perceptions et de leur discernement).
![]()
Remettre en question son éducation est difficile en raison de la loyauté invisible, de la dette et des serments familiaux (généalogie).
Il est néanmoins intéressant de se saisir du contexte familial passé (la réalité d’un individu est sa réalité subjective), qu’il soit réel : « j’étais éduqué à la dure » ou fantasmé : « mon enfance était tout à fait normale et heureuse » pour donner du sens aux émotions primitives et leur permettre d’être symbolisées (conversion de l’émotion dans le sentiment représentatif) et verbalisées au présent.
Ainsi, pour faire exister le ressenti à posteriori, sa perception intuitive éclaire le cadre affectif et symbolique : « comme mes parents étaient ouvriers (réalité) et insatisfaits (sentiment) de leurs statuts (rôles), ils étaient autoritaires (représentation) car je devais réussir socialement (désir) » pour favoriser la projection des émotions fondamentales qui ne se seraient pas libérées dans le passé par leur symbolisation lors de leur premier ancrage : « je n’étais pas conforme (non-reconnaissance) aux attentes (désir) de mes parents, ils ne me faisaient pas confiance (carence affective d’estime), j’avais terriblement peur de les décevoir (sentiment), je me suis alors soumis (comportement) à leurs envies (désir de l’autre) et j’obéissais à leurs exigences (injonctions) pour ressentir (intention) la joie de leur satisfaction mais j’étais démuni (frustration), à cette époque (regret), de la capacité de raisonnement (discernement), je perçois maintenant la réalité de ce monde déshumanisé (représentation) dans lequel j’étais l’objet de mes parents (représentation de soi), conditionné pour devenir un employé obéissant (déterminisme) ».