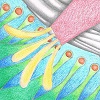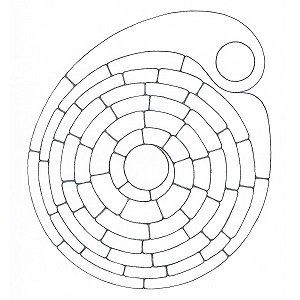![]()
L’individu compense sa faiblesse perceptive ressortant de son incapacité à saisir le principe de la réalité (chose en soi) par sa faculté d’imagination et d’interprétation suivant le rapport de causalité : « devant l’effet j’en cherche la cause ».
Son insuffisance constitutive à reconnaître son paysage le plus proche (soi) prive sa conscience de la perception (intuition) d’un territoire étendu par-delà les choses (significations, intentions, buts) interdisant leur dépassement (transcendance).
Ainsi, lorsqu’il questionne les événements de son existence, l’être humain tente une réponse par la rationalité (espace de compréhension), en l’absence d’explication logique, il répond par la croyance (espace d’espérance).
La croyance est donc une recherche de sens dans l’impossibilité de certitude.
Dans ce sens, la croyance apporte une réponse probable à une question possible par la liberté de l’imaginaire qui soutient la création de la pensée : « croire en la possibilité de mon évolution est une idée qui ne se nourrit d’aucune preuve et ne présente aucune certitude mais qui engage ma volonté et l’espoir de mon désir en dehors d’une réalité immédiate et concrète ».
Croire est une faculté mentale, au même titre que connaître et savoir, abolir cette capacité c’est faire l’impasse sur l’anticipation, la confiance, l’espérance, l’éventualité, l’incertain, l’envisageable, l’imaginaire et la poésie de l’inconnu.
![]()
La croyance plonge ses racines dans l’environnement, l’éducation et l’affectivité.
Aussi diversifiées que les individus : « je ne crois pas en ceci si je crois en cela », les croyances sont toujours reliées au passé les ayant construites.
La pensée d’un individu, liée à sa personnalité profonde, forme alors la croyance comme un produit de sa sensibilité et de son histoire confronté à son ignorance et à sa quête de réponses.
C’est ainsi que : « penser que je connais précisément les causes qui me font agir est une méprise (illusion) car les raisons fondamentales sont inconscientes, échappant à la surface de ma conscience ».
La croyance se construit essentiellement sur des objets d’espoir (désir) ou de crainte (peur) liés à l’insuffisance du discernement et au désir de comprendre en produisant de la pensée. Les croyances sont également les images symbolisées dans les formes-pensées collectives (archétypiques) et conventionnelles (standardisées) réduisant l’affirmation des choses à des figures courantes dont la verbalisation n’est plus nécessaire.
![]()
L’individu qui s’attache davantage aux croyances qu’au savoir concret et à la connaissance authentique croit en des choses car « il faut bien croire en quelque-chose » et en ignore d’autres car « on ne peut tout croire » alors, « croyant bien faire », il néglige la bienveillance car « il n’est pas bon d’être trop bon », il étouffe ses émotions pour « ne pas déranger », écarte leurs significations car « elles paraissent incompréhensibles » en méconnaissant la possibilité de la tranquillité « puisqu’il y a toujours quelque chose qui cloche » mais, comme il s’ignore profondément, il « croit en lui-même » car « chercher à savoir ne sert à rien d’autre qu’à causer du tracas ».
Un raisonnement par la croyance est une compréhension automatique de la réalité court-circuitant les procédures concrètes d’exploration, de discernement et de confirmation.
Le recours à la croyance dans une situation difficile dévoile alors l’état de méconnaissance de soi et expose le mécanisme défensif par lequel la conscience adoucit une réalité insupportable par une illusion pour s’en protéger : « je ne devrais pas être triste car j’ai tout pour être heureuse ».
Si la croyance nie et rejette la réalité avec une conviction inébranlable, elle réfute la logique, la raison et la connaissance : « le bonheur existentiel est dans la possession matérielle ».
Il s’agit bien d’une croyance (manipulation) lorsque la société productiviste rejette les idées humanistes et bienveillantes en les désignant comme utopiques.
« Si je crois que je ne peux objectivement mieux (rien) faire et que j’ai tout tenté pour régler mon problème existentiel et modifier le cours de ma vie », ma pensée relève du sophisme (raisonnement faux visant à tromper), de l’obscurantisme (négation du savoir et du progrès) ou de l’ostracisme (exclusion d’une réalité).
Une croyance est donc la fabrication d’une pensée utile mais irréelle qui se prend subjectivement pour la réalité : « je suis le chef ! » (identification à l’autorité), « je pense, donc je suis ! » (conviction d’une incertitude), « je ne commets jamais d’erreur ! » (invincibilité - peur de soi), « je ne sers à rien ! » (jugement – désir de l’autre), « l'avenir appartient à nos enfants ! » (infantilisation), « je fais tout mal ! » (défaut d’estime – désir de soi).
La croyance est également une illusion (fausse vérité) qui se prend objectivement pour la vérité : « tu me dois le respect ! » (obligation), « il faut travailler dur pour réussir ! » (rôle - statut), « je te punis pour ton bien ! » (perversion), « l'avenir est dans la science ! » (déresponsabilisation).
La croyance se déploie par ses intentions, toutes les croyances n’ont donc pas la même énergie d’engagement affectif : « je pense qu’il va pleuvoir » porte une charge émotionnelle moins intense que « je crois que tu mens ».
![]()
Les croyances se justifient uniquement lorsqu’elles caractérisent le réel et symbolisent les ressentis et les intuitions confrontés à une réalité incertaine, possible ou probable en soutenant pleinement la correspondance de l’individu à sa propre réalité.
L’individu ne peux vivre toutes les expériences du monde mais il acquiert la connaissance de celles qui sont nécessaires à son évolution.
De la même façon, « je ne peux trouver toutes les réponses mais toutes mes questions trouvent mes réponses ».
![]()
Croire avec le doute de sa croyance est une manifestation de sa propre liberté (autonomie idéique), croire avec le discernement du doute et le doute du discernement rapproche ainsi la conscience de l’authenticité de l’expérience : « je crois, mais je doute de ce en quoi je crois ».
La pensée raisonnable et attentive permet de réduire la charge émotionnelle dégagée par une croyance, douter de ses croyances est alors une révision complète de soi : « par le doute, je cherche les raisons réelles de ma réalité ».
L’individu reprend ainsi la maîtrise (discernement) de ses perceptions par une conscience logique et rationnelle (simplicité, sensibilité, raisonnement, causalité, déduction, sagesse, méthode, lucidité) pour adapter sa pensée à sa réalité.
La refonte des pensées évite les erreurs d’interprétation (sectarisme) et les comportements produits des idées fausses (fanatisme).